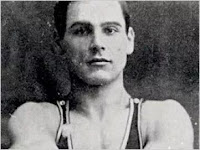Comment j’ai appris à me servir de mon grand pouvoir est une longue histoire, bien trop longue pour vous la raconter de A à Z, de peur que vous mourriez avant d’en connaître la fin. Je suis très sérieux. Ce pouvoir est si grand, si inconcevable pour un être ordinaire comme moi, que je n’avais pas même le soupçon de son existence avant ce jour mémorable de juillet. De son existence en moi ! Et depuis le commencement ! Depuis que j’ai conscience du monde, ou peut-être même avant pour ce que j’en sais. Il était là, au fond de moi, et je n’en ai rien su. Croyez-moi, cette révélation m’a stupéfié au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer (car en vérité vous ne pouvez imaginer ce que c’est d’être doué d’un tel pouvoir).
Il a fallu que cet étranger — cette créature plutôt — arrive dans la région pour que je commence à entrapercevoir la nature de ce pouvoir. Quelle terrassante responsabilité est devenue la mienne ! Qui aurait cru que le détenteur d’un tel pouvoir prendrait la forme d’un être aussi minuscule, aussi insignifiant que moi ! Et pourquoi ici, dans ce semi-désert ?
J’habite dans une de ces parties du monde qu’on qualifie de pays chaud, avec toutes les images de cartes postales qu’on y associe, plages, lagons de rêve, mer bleue et transparente, cocotiers et bananiers. Mais la vérité est qu’il n’y a rien de tout ça ici, en tous cas pas aussi loin que je suis allé. Je n’ai jamais vu la mer par exemple, sauf justement sur des photos ou à la télé. Pas de plages blanches ou dorées, pas de cocotiers, pas même de ces forêts luxuriantes qu’on appelle jungles. Il fait juste chaud et le soleil est brûlant toute l’année, à peine moins l’hiver que l’été (si on peut qualifier les saisons locales d’hiver et d’été). La végétation autour de la case — appelez-la maison si vous voulez mais c’est plutôt une case, avec un toit de tôle et des fenêtres à volets avec persiennes mais sans vitre (pour quoi faire les vitres ?) — est sauvage en apparence, je veux dire hostile, mais sans le côté pittoresque qu’on voit dans les films ou les livres pour enfant. Personne n’a envie de s’y promener et de toute façon ce n’est pas possible : essayez donc de traverser cette lande plus ou moins rase, pleine de buissons épineux si touffus qu’en moins de dix mètres vos habits seraient changés en charpie ! Même mon grand pouvoir ne peut rien contre ça.
Les arbres, des arbustes plutôt à vrai dire, ont eux aussi des épines mais il n’y en a pas beaucoup ici. Peut-être à cause du vent, un vent sec, qui ne rafraîchit rien, bien au contraire, ou peut-être à cause du sol qui n’est pas très bon (c’est pourquoi il y a très peu de cultures dans le coin et je suppose que c’est la raison pourquoi il y a aussi peu d’habitants). Malgré cette topographie végétale presque rase, il y a beaucoup de lianes, de toutes les sortes, rampantes, grimpantes, et toutes sans exception je crois bien ont elles aussi des épines. La raison de toutes ces épines chez ces plantes est, si j’en crois ce que j’ai lu, de se protéger de la dent des herbivores. Mais je n’ai jamais vu beaucoup d’animaux là-dedans, même pas des biquettes. Alors peut-être que ces animaux ne sortent pour manger que la nuit. Qui sait ? Moi, je dors la nuit.
Certaines de ces lianes ont des fleurs qu’on remarque, de très jolies fleurs, aux couleurs vives, rouges, bleues, blanches, violette, orange, et ces fleurs donnent des fruits excellents au goût mais pas très juteux. Pensez à des fruits de la passion mais beaucoup plus petits et d’ailleurs c’est probablement ce qu’ils sont, des fruits de la passion sauvages.
Si donc vous voulez vous représenter l’endroit où je vis, il faut imaginer une sorte de steppe vaguement accidentée, dorée ou grise selon la saison, c’est-à-dire selon le degré de sécheresse, avec quelques points vert vif très localisés qui apparaissent après les rares pluies et des plaques noires là où la roche est à nu ou bien là où le dernier feu de brousse est passé (en effet la roche ici est aussi noire que du charbon).
La case que j’habite se situe au milieu de cette brousse. Les autres maisons sont abandonnées pour la plupart mais pas toutes. Certaines ont même été déjà colonisées par les lianes dont j’ai parlé plus tôt. Cela forme des vagues végétales indistingables du reste pour un voyageur de passage (mais il n’y en a jamais, sauf cet étranger dont je dois vous parler avant de l’oublier). Parfois un arbre plein d’épines réussit à passer par un trou du toit, une fois que la tôle est bien rouillée, ou bien emportée par une tempête. L’un de ces arbres sorti d’une ruine juste en face de chez moi présente tous les trois ou quatre ans des gros fruits épineux, bleu gris, qui me font penser à ces boules qui garnissaient les fléaux d’arme des chevaliers du Moyen-âge (je l’ai vu dans un livre). Le truc le plus bizarre est que je n’ai jamais vu ces fruits nulle part ailleurs dans la région. Peut-être que cet arbre vient d’un fruit exotique que l’ancien propriétaire avait dans sa coupe de fruit et qu’il a laissé en partant, qui sait ? En tout cas, c’est la seule explication logique que j’ai pu trouver.
En y réfléchissant (je ne peux pas m’empêcher de réfléchir à cet arbre aux drôles de fruits vu qu’il se trouve en face de ma véranda et que la véranda est l’endroit de la maison où je passe le plus de temps) je crois plutôt que c’est un cadeau involontaire de l’étranger. Je me souviens en effet l’avoir vu manger un de ces fruits la première fois qu’il est venu. Il a dû jeter un pépin, ou un noyau ?... en passant devant la vieille barraque et cet arbre est apparu un beau matin. Oui, je ne l’ai pas dit mais cela fait un certain temps que l’étranger est venu pour la première fois.
La case que j’habite est aussi occupée par une femme et, parfois, sa fille. Mais je vois de moins en moins souvent la jeune qui a probablement une autre adresse. J’ignore si elle m’appartient — la case, pas la femme — et cela m’est en fait bien égal car je ne suis pas attaché à cette maison ni d’ailleurs à aucune autre. Mon idée est que je n’en suis que le locataire à quelque titre mais le fait est que j’ai aucun souvenir de mon arrivée ici. Et non, cet oubli ne me surprend pas. C’est dans l’ordre des chose, vous comprendrez bientôt pourquoi.
Si je devais me décrire comme j’ai décrit l’endroit où je vis mais en plus résumé, je dirais que j’ai moi aussi pas mal d’épines. Je dirais surtout que je suis une personne solitaire. Je ne le dis pas pour me faire plaindre mais parce que c’est un fait et que c’est d’ailleurs l’état qui me convient le mieux. Et — pour être honnête — c’est l’état qui convient le mieux à tout le monde. Quand vous possédez un pouvoir aussi grand que le mien, sans possibilité réelle de le contrôler, il est dangereux de se trouver trop près.
Vous me direz qu’il y a cette femme et sa fille qui cohabitent, pourrait-on dire, avec moi. En fait nous nous croisons rarement. La case est plutôt grande maintenant (c’est pourquoi j’ai dit que vous pouviez l’appeler maison, ou château comme dit ma colocataire, même si elle ressemble plus à une case selon moi) et je crois que nous avons pris des dispositions à une époque que j’ai oubliée pour ne pas nous gêner les uns les autres. Quelles pièces nous pouvons utiliser, à quel moment, quand nous pouvons utiliser la voiture (car il n’y en qu’une pour trois), pour combien de temps, etc.
Personnellement, je n’ai pas de problème avec ma propriétaire (je pense à la réflexion que cette femme est la vraie propriétaire de la case car sinon pourquoi serait-elle là ?!). Pour le savoir, il faudrait que je lui parle et je ne lui parle pas. Sa fille m’ennuie davantage. Elle n’est pas réglée, fait des irruptions intempestives, ne comprend pas que nous ne sommes pas de la même génération et qu’en somme j’ai besoin de mon espace vital, comme on dit. J’ai l’impression que nous ne parlons pas le même langage, quoique nous utilisons généralement la même langue, quoique je connaisse le sens de chaque mot qu’elle emploie. Et quand, ou plutôt si je lui parle — ce qui est rare — je vois bien à son expression qu’elle ne comprend rien non plus. Elle a les yeux écarquillés, les sourcils froncés et les oreilles dressées comme si elle devait décrypter une langue étrangère particulièrement difficile. Peut-être pense-t-elle que je suis étranger, moi aussi, Russe ou dieu sait quoi !
En dehors de ces deux personnes, et de deux ou trois gamins qui vont et viennent sans que je sache d’où ils sortent, je ne vois pour ainsi dire personne et comme je l’ai dit, cela convient à tout le monde. J’ai en effet un métier qui me dispense d’avoir des relations avec autrui, en plus d’habiter dans cet endroit désert. Et les rares visiteurs sont pour la femme ou sa fille (je me demande parfois si ce n’est pas sa sœur cadette car elles se ressemblaient tout de même beaucoup ces deux-là). C’est pourquoi quand l’étranger est venu pour la première fois et qu’il m’a fait demander, j’ai su aussitôt que cela devait avoir trait à mon pouvoir. Car bien que je ne connaissais pas l’existence de mon pouvoir à ce moment-là, j’en connaissais les effets ! Comprenez-vous ? De même qu’on peut constater les effets d’une maladie sans connaître rien de cette maladie ni même savoir qu’il s’agit d’une maladie, on peut constater les effets d’un pouvoir comme le mien sans comprendre d’où cela vient. C’est même impossible à manquer.
Une autre raison (ou peut-être est-ce la même, allez savoir ?) qui faisait que j’ignorais mon pouvoir est que celui-ci ne se manifestait alors que la nuit, ou du moins quand je dormais, à mon insu donc. Ainsi il m’arrivait de me réveiller le matin et de trouver que l’une de mes colocataires avait rajeuni de dix ans ou le contraire. Cela m’ennuyait beaucoup car je ne savais plus qui était qui, je veux dire entre les deux femmes qui habitaient ici, sans parler des enfants qui changeaient eux aussi beaucoup. Ce n’est que maintenant, après que l’étranger m’ait rendu visite, que j’ai réalisé qu’il n’y avait en réalité qu’une seule femme dans cette case. Je ne sais pas ce que je me figurais à l’époque pour m’expliquer ces changements mais jamais avant la venue de l’étranger, je n’ai eu l’idée que j’en étais le responsable.
Mon pouvoir ne s’arrête pas aux limites de la maison ou du jardin (si on peut appeler des friches un jardin). Ai-je déjà dit que les passants étaient rares dans le coin ? Oui, je vois que je l’ai dit (j’ai dû me relire car je ne m’en souvenais pas). En effet, en plus d’être sauvage, le site avait la réputation d’être un endroit à éviter. On l’appelle d’ailleurs par ici la Zone. Des imprudents ou des ignorants, des étrangers, je veux dire des hommes normaux mais pas de la région, ou des chasseurs (il y a des sortes de cailles et de poules sauvages dans cette lande ainsi que d’autres gros volatiles qui ne volent pas du tout) ou des livreurs d'Amazon ont disparu pendant des années alors qu’ils passaient ici avant de réapparaître subitement, sans explication crédible. Certains avaient cru mourir de vieillesse avant de pouvoir sortir de la Zone. D’autres avaient vu leurs mouvements se ralentir progressivement, comme saisis d’une paralysie croissante et il leur avait fallu des jours et des nuits avant de franchir la distance, pourtant ridicule à vue d’œil, les séparant de ma case, et ils en avaient franchi le seuil presque mort de soif et de faim.
Un autre effet de mon pouvoir, ou disons un effet secondaire, est ma mauvaise mémoire. En effet, quand il s’écoule des mois ou des années en l’espace d’une nuit (et parfois bien moins qu’une nuit), vous oubliez forcément beaucoup de choses.
Quand l’étranger arriva enfin — je dis enfin parce que cela faisait des années, plus probablement des siècles qu’il me cherchait — la nuit était tombée depuis plusieurs heures. Je n’avais pas l’habitude de recevoir quelqu’un à une heure aussi tardive, ou d’ailleurs à n’importe quelle heure. En fait, je devais être déjà au lit si je ne dormais pas encore.
C’est ma colocataire qui reçut l’étranger. Elle n’est pas facile à désarçonner aussi ne s’alarma-t-elle pas outre mesure que le visiteur fût entré sans attendre l’ouverture de la porte. Naturellement, celle-ci était fermée et verrouillée à cette heure. C’est du moins ce qu’elle me dît ensuite et je l’ai cru car elle ferme toujours la porte à la nuit tombée : c’est une chose qu’elle n’oublie jamais. Comment était-il entré ? Elle n’en avait aucune idée. Plus tard bien sûr tout s’éclaira mais elle ne pouvait pas le savoir à ce moment-là.
C’est le bruit de la canne de l’étranger qui l’avertit de sa présence. L’homme, si on peut dire, était très bien habillé, comme pour une visite officielle avait-elle pensé, ce qui voulait dire, selon elle, que l’on avait pensé à moi en très haut lieu (ne me demandez pas ce que signifie cette phrase dans sa bouche, je n’en sais rien). Il portait des gants blancs en cuir d’agneau, qu’on ne voit guère dans nos régions, si tant est qu’on en voit d’une autre sorte, et un chapeau qui semblait plus destiné à voiler ses traits qu’à le protéger du soleil (mais c’était la nuit comme j’ai dit). Sa canne brillante comme de l’argent ajoutait à son apparence intimidante. Cet article n’était cependant pas uniquement pour l’apparat car l’étranger démontra aussitôt des difficultés considérables à se déplacer sans celle-ci et en fait, même avec elle. Ce n’était pas vraiment la démarche d’un boiteux mais celle d’un qui n’aurait jamais appris à marcher sur deux jambes, faisant songer à un bambin qui aurait commencé à abandonner la position à quatre pattes. Comment dans ce cas avait-il pu parvenir jusqu’ici, dans cet endroit reculé, sans véhicule, où tant de gens mieux bâtis avaient perdu leur chemin — ou leur temps ! — presque mortellement est une question qu’elle ne se posa pas. Au lieu de quoi, elle accueillit le visiteur comme si sa venue était des plus naturelles et comme si son infirmité était une excentricité pardonnable. Le visiteur titubait plus qu’il ne marchait et durant cette nuit, il tomba à plusieurs reprises quand, dans l’excitation de la conversation, il oubliait sa canne ainsi que son infirmité.
Mais le trait le plus saillant de sa personne n’était pas sa canne mais ses lunettes. À cause de sa canne, de sa couleur, on aurait pu croire qu’il était aveugle, qu’il n’avait pas d’yeux. Au contraire, il en avait trop ! L’appareil optique qu’il portait sur la face et que la femme appelait des lunettes était en effet constitué d’une bande métallique qui lui faisait le tour de la tête avec de petites guichets disposés irrégulièrement tout le long. En plus, la bande métallique n’était pas centrée un peu en dessous de la racine du nez, là où se trouvent les trous des yeux en principe mais un peu au-dessus. Que la femme n’ait rien remarqué est vraiment extraordinaire ! Mais après tout, elle n’avait rien remarqué non plus quand elle se réveillait avec dix ans de plus (ou de moins, je ne sais plus).
Tout cela, ai-je compris plus tard, était un effort de l’étranger, dicté par son aimable caractère, pour nous ressembler le plus possible, mais avec un succès que l’on pourrait qualifier de mitigé.
En dehors de ces « excentricités » comme dit ma colocataire, le visiteur avait un air respectable, un sourire qui donne confiance (tout du moins pour la partie visible du visage), des manières simples et l’élocution aisée.
— De quoi voulez-vous me parler à cette heure ? ai-je demandé au visiteur, car j’étais tout à fait réveillé à ce moment.
— À cette heure comme à une autre, a-t-il répondu avec son drôle de sourire.
— Bon, qu’avez-vous à me dire de si urgent ? ai-je reformulé.
— Mais le temps bien sûr. Nous allons parler du temps qu’il fait. De quoi d’autre parlerions-nous ? a-t-il rétorqué en se tournant vers ma colocataire avec un air béat comme si c’était elle qui avait posé la question.
Puis il s’est mis à rire doucement avant de poursuivre :
— Voyez-vous, chère madame, l’homme avec qui vous avez la chance de partager ce toit, est une des deux personnes les plus puissantes que recèle l’univers entier. Et l’univers que je connais est beaucoup plus vaste que ce qu’en connait l’humanité.
La femme à qui il s’adressait est restée un instant sans répondre, observant fixement le visiteur, avant de partir d’un grand rire bruyant.
— En voilà un bonimenteur ! chuchota-t-elle en se cachant la bouche et en la tordant de mon côté. Il veut nous vendre quelque chose, je crois bien.
— Oh bien sûr, continua l’autre sans se laisser perturber, il le cache bien. C’est pourquoi j’ai mis tant de temps avant de le localiser. Il veille bien à ne se servir de son pouvoir qu’en cas d’extrême nécessité. Car le paradoxe est que lorsqu’un pouvoir devient si grand, une personne responsable ne peut s’en servir que selon des circonstances très particulières et très rares qui, dans la pratique, ne se trouvent presque jamais réunies. Mais la source d’un tel pouvoir ne peut rester longtemps inconnue, malgré toutes les précautions qu’on peut prendre. Rien ne peut échapper à mon regard perçant, chère madame. Encore faut-il penser à regarder au bon endroit.
— Et quelle est la seconde personne la plus puissante de l’univers ? a demandé ma colocataire en gloussant et en clignant de l’œil grossièrement de mon côté comme si tout cela était une plaisanterie qu’elle était bien décidée à savourer jusqu’au bout.
En guise de réponse, l’étranger se contenta de pointer son index en direction de la porte et celle-ci s’ouvrit. Mais elle ne s’ouvrit pas comme une porte est censée s’ouvrir, elle ne pivota pas sur ses gonds, on aurait dit que l’interstice entre le battant et le chambranle s’était soudain dilaté jusqu’à pouvoir laisser le passage à un homme.
La femme ouvrit des yeux ronds à la vue de ce prodige mais se reprit presque aussitôt et regarda le visiteur avec un sourire ironique comme si c’était une sorte de vulgaire prestidigitateur qui faisait apparaître des lapins dans son chapeau.
— Ceci est un petit échantillon de mon pouvoir, poursuivit l’étranger. Disons que c’est ma carte de visite. Je suis en effet la seconde personne la plus puissante de l’univers, comme vous l’avez deviné. Et quand je dis la seconde, je pourrais aussi bien dire la première ! ah, ah ! voyez-vous cette étoile par l’ouverture que je viens de créer dans votre maison ? Eh bien je pourrais nous y emmener en un clin d’œil, tous les trois avec cette maison en guise de vaisseau interstellaire.
— Comment faites-vous ça ? ai-je demandé avec une sincère curiosité.
— Un scientifique vous répondrait sans doute que cela à voir avec la gravité, répondit-il. Il existerait selon eux des particules invisibles, qu’ils appellent des gravitons bien qu’en vérité ils n’en aient jamais trouvé un seul, et ces particules infimes seraient la source de la force cosmique, celle qui attire les planètes et les étoiles. Et ils supposent qu’il existerait aussi leur symétriques, des anti gravitons qui repoussent les corps célestes. Eh bien disons que je commande aux deux. Je peux contracter l’espace ou au contraire le distendre, je peux créer des dimensions là où il semblait ne pas y en avoir ou réduire l’espace en un seul point. Je pourrais ainsi faire disparaître cette maison de la vue du monde entier. Oh, ne craignez rien, elle ne disparaitrait que pour un spectateur extérieur, vos voisins par exemple ; pour vous, il n’y aurait rien de changé.
— Sauf si nous voulons en sortir, ai-je remarqué. Nous serions alors plus petits que des Lilliputiens.
— Exact.
— Et si au lieu de ça, vous faisiez grossir cette maison jusqu’à ce qu’elle soit aussi grande qu’un centre commercial de quatre étages, est-ce que nous deviendrions des géants ? demanda ma colocataire d’un air soudain très intéressé.
— Absolument. Relativement au monde extérieur, vous le seriez.
— Hum, faites donc ça et je vais rendre visite à une de mes voisines ce soir-même. Je vais lui flanquer la peur de sa vie à cette harpie !
— Eh bien, c’était une illustration. La vérité est que je ne pourrais pas changer la taille de cette maison sans changer un bon bout de cette planète avec et ce ne serait pas une bonne idée, croyez-moi. Demandez plutôt à votre locataire. Il peut faire ça mieux que moi.
La femme se tourna vers moi, m’observant avec un œil sceptique.
— Il peut me transformer en géante, vraiment ?
— Non, mais il peut réduire la maison de votre voisine en un vulgaire tas de pierre ou même en poussière. Ce serait un jeu d’enfant pour lui. Et vous seriez débarrassé de votre voisine encombrante.
— Non, je ne peux pas faire ça, ai-je répondu.
— Bien sûr que non. Vous êtes un homme sage, responsable, équitable, patient, magnanime, comme moi-même. Mais le point important est que vous le pourriez si vous le vouliez.
— Non, ai-je répété.
Et j’ai dû avouer à la seconde personne la plus puissante du monde que je ne contrôlais pas mon pouvoir comme lui, en fait que je ne le contrôlais pas du tout, à tel point que j’ignorais encore avant qu'il ne me le dise que je possédais ce pouvoir.
— Ce n’est que la nuit, quand je dors, que ça marche, ai-je ajouté, soudain saisi d’une illumination.
— Voilà qui est fort ennuyeux. Et même fort dangereux, a dit l’étranger, songeur. Le monde pourrait fort bien ne pas se réveiller un de ces jours pendant que vous dormez.
— Et moi aussi ? demanda ma colocataire.
— Hélas, c’est fort probable.
— Si je comprends bien, vous êtes en quelque sorte le Maître de l’air et lui (elle me désigne de son pouce) est le Maître du temps ? c’est bien ce que vous dites.
— Avec des mots moins jolis que les vôtres, chère madame, mais c’est tout à fait ça.
Ma colocataire parut avoir un moment d’intense réflexion.
— Pourrait-il me faire revenir au temps où j’étais jeune, vingt, vingt-cinq, vingt huit pas plus ?
— Eh bien, c’est un peu plus compliqué que ça. Le temps, contrairement à l’espace, ne marche que dans un seul sens pour nous autres mortels. Il avance toujours et ne recule jamais.
— Il ne pourrait même pas me rajeunir s’il voulait et vous appelez ça un grand pouvoir ?! Vous vous fichez de moi !?
— Oh mais il ne cesse de le faire : quel âge pensez-vous avoir ?
— Eh bien l’âge qui est marqué sur mes papiers d’identité.
— C’est là où vous faites erreur, chère madame, si je puis me permettre. Vos papiers indiquent votre date de naissance qui en effet ne peut être changée. Mais ils n’indiquent pas votre âge. Nullement. Rappelez-vous mon illustration à propos de votre maison si je m’amusais à la grossir jusqu’à la taille d’un centre commercial selon vos souhaits. Vous, à l’intérieur, ne vous rendriez compte de rien, à moins de regarder par la fenêtre. Mais pour les gens de l’extérieur, votre maison aurait réellement poussé comme un champignon durant la nuit. Comprenez alors que le pouvoir de votre locataire fonctionne de façon assez similaire, sauf que c’est le temps qui se dilate ou se contracte au lieu de l’espace. Pour l’avoir si longtemps recherchée, je peux vous certifier que le temps dans cette maison ne s’écoule pas du tout à la même vitesse que dans le monde extérieur. D’après mes calculs, cela fait environ cinq siècles que cette maison n’a pas pris une seule année complète. Ce n’est peut-être pas un rajeunissement au sens où vous l’entendez mais c’est à ma connaissance ce qui se rapproche le plus de l’éternité pour nous autres, créatures de chair.
— Ah, il me semblait aussi que les saisons étaient bien longues ici… Mais comment alors se fait-il que mes voisins ne soient pas tous des vieillards ? Et pourquoi lorsque je descends en ville, je trouve que les gens n’ont pas tant changé que ça ?
— Cela ne prouve qu’une chose : que le rayon d’action du pouvoir de votre locataire excède le rayon de vos déplacements. Vous n’avez jamais quitté la Zone, chère madame, et croyez-moi : grand bien vous en a pris.
— Ah, cela explique pourquoi à chaque que je vais rendre visite à ma fille, j’ai l’impression qu’elle a pris un sérieux coup de vieux. Elle habite de l’autre côté de la montagne.
— Vous pourriez demander à votre locataire qu’il étende la Zone jusqu’à l’endroit où vit votre fille.
— Je ne peux pas, ai-je répété. Je ne sais pas comment faire ça.
— Alors dites-lui de venir s’installer chez vous.
— Mais elle a un mari et des enfants. Hum, du moins c’étaient des enfants la dernière fois que je les ai vus.
Ma colocataire réfléchit encore une minute.
— Cela m’embêterait que ma fille vieillisse et meure avant moi. Qu’est-ce que je ferais sans elle ? Il faut certainement qu’elle revienne vivre avec nous. Alors je crois vraiment pour ça que cette case va devoir s’agrandir. Faisons un marché, d’accord ? Vous dilatez notre maison pour en faire, disons, un château. Un grand et beau château. Sûr que vous pouvez faire ça avec votre grand pouvoir. Et en contrepartie, je vous offre le loyer gratis. Pensez à l’avantage : vous bénéficierez ici de la vie éternelle ou presque. Nous allons, moi et mon locataire (je ne veux surtout pas qu’il s’éloigne de moi d’un seul mètre maintenant), aller chercher ma fille pendant que vous faites vos petits arrangements architecturaux… Ah, et si vous pouviez aussi rapprocher la mer, ce serait encore mieux, j’ai toujours voulu avoir une maison en bord de mer…
Ce texte que vous venez de lire n'est pas une histoire. C'est un rêve, de ceux qu'on fait en dormant (quel plus grand pouvoir a-t-on que dans nos rêves!). Comme souvent lorsque je fais un rêve mémorable, je prends des notes le jour même, au réveil (l'idéal serait de pouvoir prendre des notes pendant qu'on rêve, en dormant, mais je n'ai pas encore réussi cet exploit somnambulique) et j'ai donc écrit ce texte plusieurs mois après à l'aide de ces notes (trente pages tout de même!). Je ne pourrais pas le publier en tant que nouvelle, conte, fable, histoire, car il n'a pas de fin, pas de sens donc, et les lecteurs généralement détestent les histoires qui n'ont pas de fin, encore moins celles qui n'ont pas de sens. Il n'a probablement pas non plus de véritable début. Je n'ai pas essayé d'inventer une fin (ou un début) bien que j'aurais sans doute pu parce qu'il aurait en quelque sorte gâché la matière brute et je tenais à garder dans la mesure du possible l'aspect non poli de ce rêve. Tout au plus me suis-je un peu écarté de mes notes pour le dialogue final.
Le sujet de ce rêve est pour l'essentiel, la rencontre entre les deux personnes les plus puissantes de l'univers, le Maître de l'Air et le Maître du Temps pour parler comme la femme du rêve ou dans les mangas. Et il se trouve que je suis l'une des deux, en tant que rêveur. On retrouve nombre de traits typiques des rêves dans le déroulement des événements. D'abord le rêveur est l'acteur principal puis, de fil en fil, il passe au second rang pour finir comme simple spectateur. Dans les rêves, l'inverse aussi arrive souvent et parfois même, j'en ai des exemples en tête, le rêveur arrive à concilier les deux rôles simultanément, car les dédoublements sont choses courantes dans les rêves. On observe également les métamorphoses typiques des rêves. Si vous y regardez de près, vous constaterez que le décor change insensiblement au cours de la narration, que les rapports entre les personnages changent, que des personnages apparaissent et disparaissent sans explication. Tout est mouvant dans les rêves. La logique qui régit les événements n'est certes pas la logique rationnelle, ni même celle qui régit les aventures d'Alice, beaucoup trop rigide dans son corset idéologique "absurde". On sent qu'il y a une logique dedans, une cohérence, mais du diable si on arrive à la définir : elle est trop souple, trop fluide, trop insaisissable.
Les analyses de Freud et consort sont des jeux d'enfant. On peut certainement y trouver du sexe là-dedans, on peut y trouver tout ce qu'on veut y trouver en réalité. Le mystère essentiel n'est pas là. Une piste plus prometteuse peut être trouvée ici.